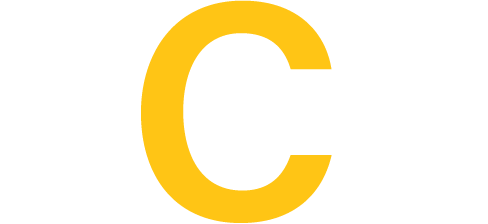- Activités
- Bulletins
- Bibliothèque
- A propos
- En 1 clic
- Vie pratique
Environnement
Les sacs de déchetsCalendrier de la collecte des déchetsParc à conteneursPetits déchets dangereux (KGA)Bien trier les papiers/cartonsBien trier le verreCompostage des déchetsMagasin de récupérationRepair-caféSignaler une nuisanceDépôts de déchets clandestinsEnlèvement de certains déchets à domicile (sur demande)
- A la découverte de…
- Ma commune
- Actualités communales
- Administration communale
- Juridictions judiciaires
- Patrimoine dilbeekois
- La légende de Sainte Alène
- La tour d’Alène
- La chapelle Sainte-Wivine
- La tour Chappe de Dilbeek
- Vestiges : Villa romaine
- Het Neerhof
- La maison Mostinckx
- Le château de Grand-Bigard
- La glacière (De ijskelder)
- De Kasteelhoeve
- Le château de Viron
- Le moulin de la Pede
- Le musée Bruegel
- Le musée du tram vicinal
- Les « konijnenfretters »
- Het Schoolmeesterhuis
- De « Wolfsputten »
- De « Golden Drop »
- Het Pampoelhuis
- Des peintres dilbeekois
- Jean Albert, sculpteur
- Infos locales
- Contact
A la découverte de Lille
Etes-vous prêts cette fois-ci encore à vous laisser « emporter » par un nouveau circuit ?
Si oui, j’ai choisi de l’insolite ! De l’inattendu !
En effet, Louis XIV nous guidera !
Suivons-le sans tarder, quand le 28 août 1667, après l’avoir conquise, il fait son entrée royale à
LILLE
capitale de la Flandre romane.
La Porte de Paris – Arc de Triomphe (1685-1692) à la gloire de Louis XIV – classée monument historique en 1875 – Place Simon Vollant

Avant de franchir la porte, pour les amateurs d’histoire prenons connaissance ensemble dans un court résumé du contexte qui poussa Louis XIV dans la guerre contre les Pays-Bas espagnols.
Note historique
Une des raisons de la guerre
Le siège de la ville avait commencé le 18 août 1667, pendant une guerre au nom étrange de Dévolution(1), ancienne coutume brabançonne revendiquée par Louis XIV qui lui permettait, à la mort du roi d’Espagne Philippe IV, dont il avait épousé la fille Marie-Thérèse, d’entrer en possession des Pays-Bas espagnols dont le comté de Flandre dépendait, et donc Lille. Le traité d’Aix-la-Chapelle mit fin à cette guerre le 2 mai 1668(2).
Réaction des Lillois
Leur résistance et leur attachement au comté de Flandre depuis plus de 150 ans furent leur réponse ! En effet, 18 compagnies de milices bourgeoises mobilisées, 1 000 fantassins, 900 cavaliers, les canonniers, les archers, les arbalétriers, les tireurs d’épée… quelque 2 400 hommes avaient répondu à l’appel du gouverneur espagnol, Philippe Spinoza et du Magistrat (= maire) de la ville. Mais face à l’armée française forte de 35 000 hommes, comment résister ? Farouchement, oui ! Jusqu’au dernier Lillois, non !
Capitulation de Lille
La tactique militaire du siège de Lille entrepris par les armées de Louis XIV sous la direction des maréchaux de Turenne et de Vauban ainsi que le bombardement de certains quartiers avaient obligé les habitants à fuir leurs maisons et le Magistrat avait été contraint de prendre une sage décision : demander au gouverneur de capituler pour éviter la mise à sac de la ville.
Après la capitulation de Lille, le 28 août 1667, Louis XIV fit son entrée triomphale, à l’endroit précis où nous nous trouvons !
Pour célébrer sa victoire, le roi commanda alors à son architecte, Simon Vollant, d’embellir l’ancienne Porte des Malades(3) (dont le nom fut changé en Porte de Paris) et où chaque élément architectural devait célébrer sa toute-puissance de droit divin.
Du haut de ses 32 mètres, cet arc de triomphe s’impose à nous ! Nous admirons la réussite de l’architecte d’avoir pu conjuguer, dans sa réalisation, la rigueur militaire par sa masse à l’élégance du style néo-classique. Pour exemples : les colonnes à chapiteaux d’ordre dorique forment un portique sur chaque travée latérale ; le corps central est creusé d’une embrasure en arcade dont les ailes sont ornées de figures mythologiques (Mars à gauche, Hercule à droite. La guerre et la force personnifiées associées au pouvoir royal). L’arc est surmonté des armoiries sculptées de la ville de Lille et du blason royal avec ses 3 lys (évocation de la Sainte Trinité).
Sur le faîte de l’arc, les figures allégoriques de la « Renommée » sonnent la victoire de Louis XIV et la Victoire, elle-même, bras droit levé, est prête à déposer une couronne sur la tête du Roi Soleil.
Sous l’arc, nous franchissons le couloir voûté et imaginons très bien l’emplacement de l’ancien pont-levis médiéval qui permettait l’accès à la ville. D’ailleurs, à ce titre, cet ensemble défensif est considéré comme « l’un des derniers chefs-d’œuvre de l’histoire militaire ». Tout le long de la rambarde, les 24 ornements de grenade en fonte nous rappellent la guerre menée par Louis XIV et sont le symbole des bombes incendiaires lancées contre les fortifications de l’ancien quartier Saint-Sauveur.
Lille française
L’acte de capitulation comportant 69 articles proposés par les échevins de la ville fut signé après une négociation avec le roi prévoyant le maintien des privilèges et coutumes de la bourgeoisie de la ville.
Les Lillois au début fort hostiles à la domination royale deviennent après quelques années, et pour diverses raisons, favorables à la France.
Et dans notre parcours, j’ai opté pour vous faire découvrir une de ces raisons qui touche au domaine de la poliorcétique, c’est-à-dire tout ce qui est relatif à l’art d’assiéger une ville, en offensive comme en défensive. Car pour la première fois, Lille va profiter du talent de l’ingénieur et architecte militaire, Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban chargé par Louis XIV d’améliorer ses fortifications, d’y construire un fort et une citadelle.
Ainsi, à quelques pas de la Porte de Paris, où nous bifurquons à droite dans la rue du Réduit, nous découvrons une de ses réalisations.
Le Fort du Réduit (= petite fortification) à l’emplacement du Fort Saint-Sauveur (existant à l’époque des Pays-Bas espagnols sous le nom de Fort Campi)

Il fut remanié fortement par Vauban (1671-1674) pour renforcer le dispositif défensif de la ville avec intégration de bastions au périmètre fortifié. Inscrit aux Monuments historiques en 1946.
Il nous faudra un peu d’imagination pour « voir » ce que pouvait être ce fort décrit par Vauban comme « une mini-citadelle » car bastionné à la fois vers la ville et la campagne. En effet, Louis XIV voulait pouvoir y poser les canons au cas où les bourgeois s’insurgeraient contre son pouvoir. Ce fort assurait aussi un point d’appui aux forces de l’ordre et permettait le repli des soldats, tout en assurant la sécurité du côté sud de Lille en cas d’attaque ennemie.
Au centre de ce fortin, on peut admirer la chapelle du Réduit, œuvre architecturale classique de 1707, classée Monument historique en 1910.
Modernisés après la 2e guerre mondiale, les bâtiments accueillent les bureaux du Génie de Lille et du gouverneur militaire et ne peuvent être visités. Nous nous contenterons d’une petite balade reposante dans le jardin y attenant, au Square du Réduit.

Cet archétype du jardin à la française créé en 1872 par Jean-Pierre Barillet-Deschamps, célèbre paysagiste, cultive l’art de la miniature et de la symétrie. Et en cherchant bien, nous trouverons un fragment de la Porte de Tournai, bâtie sous la direction de Vauban en 1673 et détruite en 1924. Ouvrez l’œil !
En quittant le square, vous m’arrêtez subjugués et me désignez une haute tour quadrangulaire, très élancée, dont le sommet flirte avec le ciel ! Non, Louis XIV n’est pas passé par-là ! Mais, nous ne pouvons faire abstraction de cette visite et nous pressons le pas vers la Place Roger Salengro, car chacun d’entre nous désire en savoir un peu plus.

 Mais oui, bien sûr ! C’est le Beffroi ! Accolé à l’hôtel de ville, l’ensemble fut érigé en 1932 par l’architecte Emile Dubuisson, et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005. Impressionnant par sa hauteur de 104 m, le beffroi est le bâtiment municipal le plus élevé de France et même d’Europe ! Et pour l’époque, il affirmait la puissance politique et économique de Lille. Le beffroi est en brique rouge et béton « façon pierre sculptée » mélangeant ainsi Art déco et architecture néo-flamande.
Mais oui, bien sûr ! C’est le Beffroi ! Accolé à l’hôtel de ville, l’ensemble fut érigé en 1932 par l’architecte Emile Dubuisson, et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005. Impressionnant par sa hauteur de 104 m, le beffroi est le bâtiment municipal le plus élevé de France et même d’Europe ! Et pour l’époque, il affirmait la puissance politique et économique de Lille. Le beffroi est en brique rouge et béton « façon pierre sculptée » mélangeant ainsi Art déco et architecture néo-flamande.
Sa hauteur nous met au défi ! Quelque 400 marches à gravir pour arriver à son sommet ! Impossible me dites-vous ! Soyez rassurés, un ascenseur prend la relève après les 100 premières marches ! Et en haut, depuis la terrasse, nous profitons d’un panorama unique, à 360° sur la ville et au-delà ! Cependant, depuis ce point de vue exceptionnel, quelques touches vertes au sol nous incitent à redescendre sur terre et à poursuivre sur les pas de Louis XIV, pour notre grande et dernière étape.
A l’ouest, toutes ! Nous marchons au moins 30 minutes en remontant la longue rue de Solférino pour découvrir, au confluent des rivières de la Deûle et du Bucquet, le lieu d’implantation de la plus parfaite des réalisations du maître des fortifications de Louis XIV, Vauban ; celle qu’il surnomma lui-même la « reine des citadelles ».
 La Citadelle selon un plan en forme d’étoile avec 5 bastions reliés par des remparts – Avenue du 43e Régiment d’Infanterie, à la limite nord- ouest de la ville. Classée Monument historique en 2012.
La Citadelle selon un plan en forme d’étoile avec 5 bastions reliés par des remparts – Avenue du 43e Régiment d’Infanterie, à la limite nord- ouest de la ville. Classée Monument historique en 2012.
Juste après la victoire de Louis XIV sur les troupes espagnoles, la première pierre fut posée le 17 juin 1668, Simon Vollant maître-maçon lillois y contribua et la citadelle fut déjà opérationnelle trois ans plus tard !
Achevée en 1673, elle avait nécessité le travail de 2 000 hommes.

Notre regard se porte d’abord sur la Deûle et son canal (en 1750 et le canal à grand gabarit en 1977), véritables ceintures aquatiques autour de la citadelle et nous comprenons le choix de cette implantation par le marquis de Vauban car à l’époque les marais, l’eau et la boue furent utilisés comme moyen défensif naturel rendant les conditions de siège les plus difficiles possibles et obligeant l’ennemi à s’emparer d’abord de la ville. Mais, souvenez-vous du Fort du Réduit, ce bastion avec ses canons qui assurait déjà la sécurité de la ville côté sud !
Parcourons maintenant les sentiers au pied des murs de la forteresse pour nous rendre compte du système de défense mis en place par Vauban et au fil de nos déambulations, l’imparable efficacité de la citadelle nous apparaît : « pas un de ses murs ne peut être approché par l’ennemi sans que celui-ci ne se trouve sous le feu d’un mur voisin ».


L’enceinte de la citadelle, de 2 km de long, est recouverte d’un parement de briques parsemé ça et là de blocs de grès, couvrant un épais remblai de terre. La citadelle s’organise en un pentagone avec cinq bastions disposés aux angles, encadrant des courtines de 49 mètres.

Nous arrivons au terme de notre circuit et laisserons Louis XIV au souvenir de son passage dans la grande allée qui mène par la Porte Royale, au centre de la citadelle, à l’ancienne garnison où 3 000 soldats veillaient à la défense de Lille au XVIIe s.
Mais, nous sommes stoppés dans notre visite ! En effet, depuis le 1er juillet 2005, date de sa création, le site abrite le quartier général du Corps de réaction rapide-France, une structure certifiée de l’OTAN. Cet état-major est « capable d’assurer le commandement d’une force terrestre nationale ou multinationale de 5 000 à 60 000 hommes ». Sur place, 450 militaires de 15 nationalités différentes s’y exercent encore aujourd’hui.
Subitement au-dessus de nos têtes un vol de pigeons ! Déployant leurs ailes, dans les nuances gris bleuté, ils sont juste magnifiques !
On dirait un message céleste pour nous rappeler que 20 000 d’entre eux sont morts en mission pendant la guerre 14-18, en transmettant des messages. Nous sommes au pied de « leur » monument élevé par la Fédération nationale des sociétés colombophiles en 1936.
Cette stèle, réalisée par l’architecte lillois Alexandre Descatoire, est la seule de France à être dédiée aux pigeons et colombophiles morts pour la patrie !
Promis, dorénavant mon regard porté sur ces oiseaux sera empreint de bienveillance !
Et vous ?
Chloé Bindels
Notes de références :
(1) Dévolution : vieille coutume brabançonne qui veut que les enfants du premier lit du roi, même les filles, aient priorité sur ceux du second.
(2) Traité d’Aix-la-Chapelle : 2 mai 1668, ce traité de paix met fin à la guerre de Dévolution entre la France et l’Espagne. Ainsi, Louis XIV apporte à la couronne : Lille,Tournai, Douai, Armentières et quelques dépendances.
(3) Porte des Malades : située sur la partie de l’enceinte de Lille du XIIIe s, entrée sud de la ville. Cette ancienne porte conduisait à l’extérieur de la ville à une léproserie, supprimée en 1670. La rue des Malades est l’actuelle rue Pierre Mauroy.
_________________
Sources :
Office du tourisme : Palais Rihour, Place Rihour – 0033 3 59 57 94 00
Archives municipales de Lille : Lille capitule devant Louis XIV – https://archives.lille.fr
Hôtel de Ville de Lille : Place Augustin Laurent – 0033 3 20 49 53 71
Visite du Beffroi de l’Hôtel de ville : https://www.lilletourism.com
Square du Réduit : https://www.lille.fr
Guide touristique : Lille en quelques jours – 8e édition – Lonely Planet, 2023
Le City Guide : Hello Lille (gratuit à l’Office du tourisme)-2023
Reportage photographique :Chloé Bindels